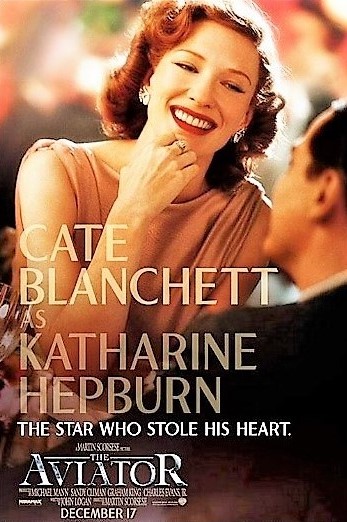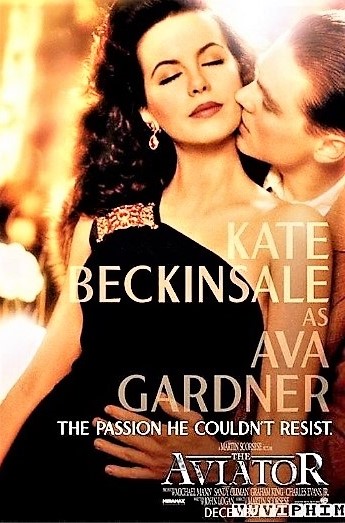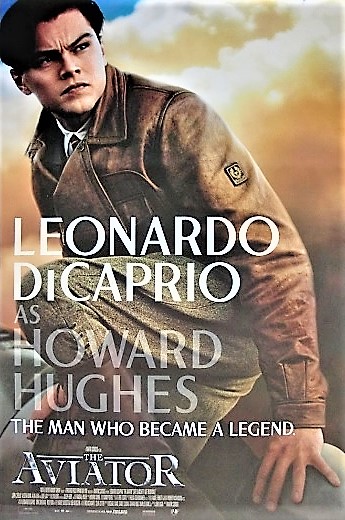hier dans les rues (les œufs en meurettes, ici cachés, se négocient à 15 ou 20 euros dans le quartier) j’ai croisé cette affiche
il s’agit d’une représentation de la Salute (laisse les gondoles à Venise chantait (si on peut ainsi dire) quelqu’un – Hervé Vilard ? – trouvé immédiatement cette image-là
qu’est-ce t’en penses ?) (jt’explique je précise : le type assis au piano, c’est lui – il est toujours parmi nous (il est de 46 je crois bien) contrairement aux quatre grâces qui l’entourent) non Sheila et Ringo – qui me font furieusement penser à Piaf et son Théo (327/480)* – il faut associer) (Stone et Charden aussi tiens) les griffures biffures me plaisent – le peintre me fait un peu braire (son marchand exclusif se trouve dans le même pâté de maison (on dit blok ces temps-ci pour faire hu esse) que le palais où l’éphémère locataire (dix ans quand même, ça fait un bail), jésuite hypocrite indigne, s’est empressé de féliciter l’ordure de son accès à un panthéon pourri – lapalissade) une église établie en remerciement à la Vierge pour avoir épargné les survivants de la peste, quatorzième siècle si je me souviens bien, portée, dit-on par plus d’un millions de pieux calcifiés – affiche qui me fait souvenir de mon oncle (il paraît que suivait son enterrement fin de siècle toute une tripotée (une théorie) d’affidés de ceux qu’il avait pour amis et partenaires commerciaux d’Afrique de l’ouest – continent qui le vit, comme le rédacteur, naître). Il tenait dans son bureau (il était courtier – maintenant, sa spécialité, je ne la connais pas) derrière lui une reproduction (je croyais en avoir une reproduction aussi mais non) dans le même esprit (ce genre de rigolade se négocie plusieurs dizaine de milliers d’euros chez le Maurice en question – Momo pour les intimes) imposant (130 sur 80 à peu près) (je tenais aussi un dessin original acheté derrière les Frari d’une maison ressemblant comme au palais occupé par Rex Harrison (alias Cecil Fox) dans le Honey Pot (Joseph Mankiewicz, 1967)) mais je m’égare : j’entrepris sur les conseils de sa sœur (ma mère donc, si tu suis) de faire évaluer la chose (j’allai chez Momo mais on m’y regarda de très haut – quel âge pouvais-je bien avoir, quarante ? – non, ici non, on n’évalue pas non) – je partis à Drouot où un type me dit, après trois secondes d’observation « c’est un faux, trois cents ou quatre cents euros – au mieux » – il y avait cette propension chez mes oncles, comme un peu si tu veux chez Claude Berri ou chez l’homme le plus riche de France ou son compère de bourse commerciale de se prévaloir d’une culture (serait-elle contemporaine) à travers des œuvres d’art : par exemple,chez un autre, un (authentique celui-là) Miro (cet oncle-là, latifundiste (vin et huile d’olive) du Latium, possédait aussi un garde-temps (une montre extra plate or jaune et rose) qu’on retrouva dans les bijoux de son épouse, brisé (je la fis réparer chez le faiseur de la place Vendôme, à deux pas de chez ce premier oncle au faux Buffet (on m’y regarda de haut : quel âge pouvais-je avoir ? quarante ? – je la conserve) – cet oncle-là avait l’habitude de descendre (comme on dit) en face de la Salute quand il se rendait à Venise (ce qu’il aimait assez). Entre ces deux oncles, deux types bruns, en éternelle concurrence, comment dire duquel il me souvient aujourd’hui ?
Enfin, j’ai tenté de reprendre le témoin du titre, ce vendredi – mais j’avais à l’esprit cette chanson de Michel Jonasz qui va avec l’abject peroxydé de nouveau au pouvoir
* : quantième Je me souviens (GP fayard 1978)




 Slimane Dazy et David Murgia dans les rôles
Slimane Dazy et David Murgia dans les rôles la cathédrale Notre-Dame de Paris en flammes, le 15 avril 2019
la cathédrale Notre-Dame de Paris en flammes, le 15 avril 2019